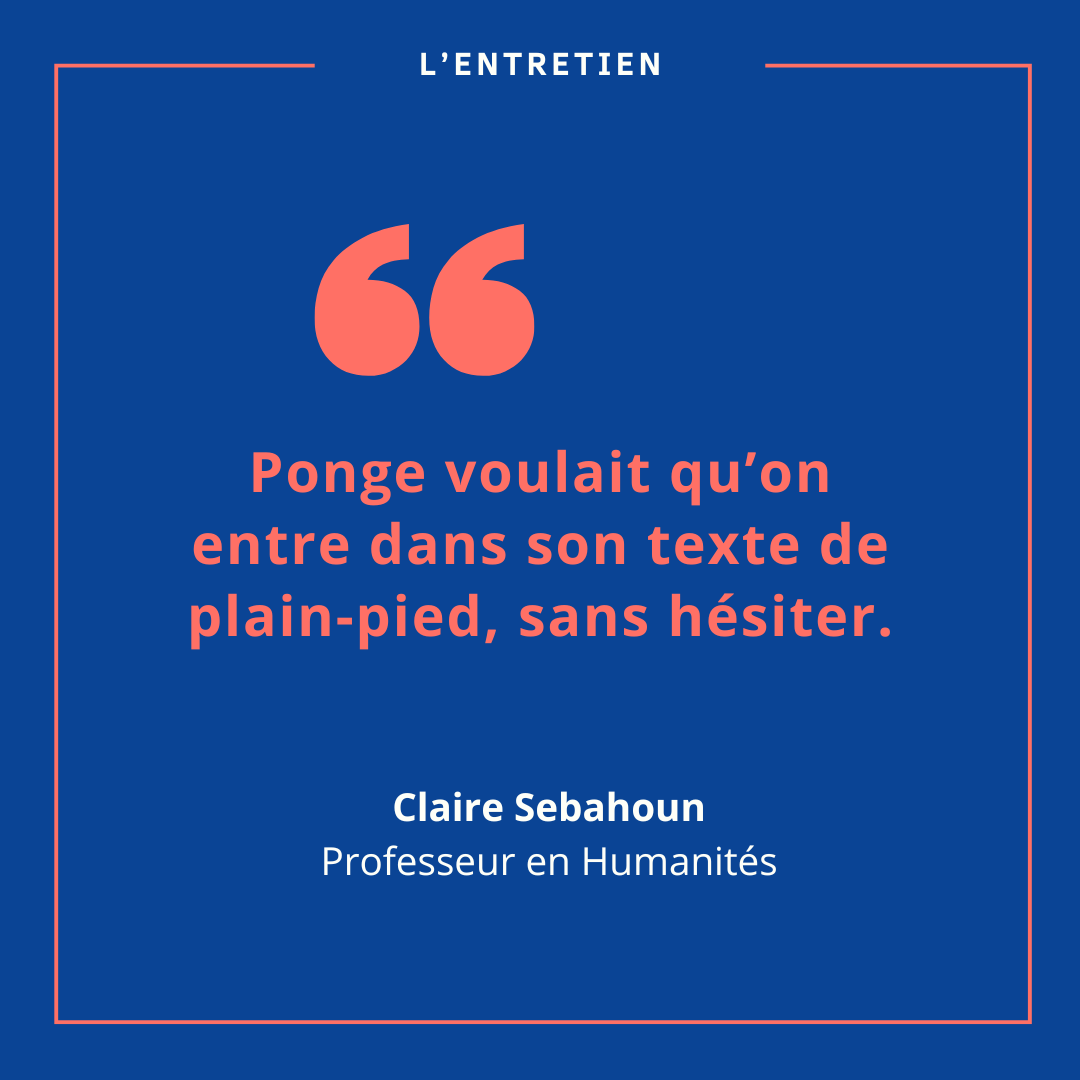
« Ponge voulait qu’on entre dans son texte de plain-pied, sans hésiter »
Galet, crevette, éponge…Dans Le parti pris des choses, Francis Ponge explique qu’il y a de la poésie partout. De la poésie, il y en a aussi dans la classe de Claire Sebahoun qui, campus après campus, invite les élèves de l’Institut Louis Germain à entrer de plain-pied dans les textes des grands auteurs. Entretien.
Claire, vous êtes professeur en Humanités, mais pas uniquement. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, c’est ma cinquième rentrée à l’Institut Louis Germain. Je suis également responsable du suivi pédagogique d’une classe préparatoire aux écoles de commerce à Aix. Et je travaille dans l’édition, ce qui m’a permis de coordonner des publications de l’Institut Louis Germain comme Une année à l’Institut Louis Germain : journal de classe et Semer les savoirs, récolter l’excellence : témoignages d’élèves, diplômés et parents.
Pourquoi avez-vous décidé d’enseigner à l’Institut Louis Germain ?
J’avais une expérience de l’enseignement dans le privé et j’étais extrêmement curieuse de me retrouver face à des élèves ayant un tout autre profil : public, REP et REP+. J’ai découvert des élèves ayant une appétence énorme pour la connaissance et une vraie curiosité intellectuelle.
Statistiquement, c’est assez rare que dans une classe, peu importe l'environnement, on trouve 100% d'élèves parfaitement intéressés par ce qu’on dit. Dans les classes de l’Institut Louis Germain, on en est très proche.
À votre avis, pourquoi les élèves participent-ils aux campus ? Et pourquoi reviennent-ils ?
Pendant les cours d’Humanités, l’Institut Louis Germain leur offre un espace d’expression presque sans limite. Comme on n’est pas enfermé dans un programme, on peut se mettre complètement au service de leurs attentes, questions et curiosités.
Ce sont des élèves intelligents et curieux, des élèves très demandeurs qui apprécient qu’on ne fixe pas de limites dans l’apprentissage, surtout par rapport à ce qu’ils vivent au quotidien dans leurs collèges et lycées où on a tendance à les laisser un peu de côté au profit des autres élèves, avec moins de facilités. À l’Institut Louis Germain, ils sont en classe avec des élèves qui ont les mêmes envies qu’eux.
Que faites-vous pendant vos cours que vous ne pourriez pas faire dans une classe de collège ou de lycée ?
J’essaie toujours de faire en sorte d’aller plus loin pour les sortir de leur zone de confort. Dans les cursus classiques, on s’autorise de moins en moins à mettre les élèves en difficulté. Il faut leur donner confiance. Mais je ne crois pas que ce soit incompatible. Quand je les mets face à la difficulté et qu’ils comprennent, ils en retirent une fierté sur laquelle on ne peut pas mettre de mots.
Ce matin, par exemple, j’ai fait travailler mes élèves de quatrième sur Micromégas, un conte de Voltaire, riche en notions philosophiques : la raison, l’empirisme... Ce sont des choses qui sont plutôt au programme de seconde, première, mais je ne le leur dis pas. Je leur dispense ce savoir-là en leur faisant comprendre que c’est à leur portée.
Pareil pour la grammaire : avec mes élèves de quatrième, j’ai commencé par un sujet de type brevet.
Je les mets face à la difficulté la plus grande qu’ils puissent rencontrer. Puis je leur explique comment résoudre le problème. Ça leur donne un horizon.
Est-ce que d’autres méthodes pédagogiques mises en place lors de vos cours ont particulièrement porté leurs fruits ?
J’aime bien les mettre face aux textes sans leur donner trop de contexte. C’est une manière de leur redonner le pouvoir de leur propre interprétation, lorsque le langage est à leur portée, bien sûr. Je les fais réfléchir à l’écrit sur un extrait sans qu’ils en connaissent la genèse pour les pousser à aller loin dans leurs réflexions. Et une fois qu’ils ont produit leurs interprétations, on peut réinscrire le texte dans son courant.
Selon vous, quels bénéfices les élèves retirent-ils de leur participation aux campus ?
De la confiance ! Vraiment. Je pense que c’est la chose la plus précieuse qu’on puisse leur transmettre. Pendant toute la semaine, on sème des graines en les confrontant aux textes. Leur confiance germe petit à petit, grandit de campus en campus.
Ils prennent confiance en eux. Ils osent poser des questions et se mettre en difficulté. Ils n’ont plus peur de se retrouver seuls face au texte. D’une certaine manière, on franchit le fossé entre les élèves et le plaisir du texte.
C’est d’ailleurs ce que souhaitait Francis Ponge, un auteur que je fais souvent étudier : il voulait qu’on entre dans son texte de plain-pied, sans hésiter.
Comment voyez-vous évoluer les élèves, campus après campus, année après année ?
Au-delà de tout ce qu’ils ont acquis en termes de connaissances, ils évoluent en tant qu’individus. Ils gagnent en confiance, en humilité, en maturité. Il y a une prise de recul par rapport à ce qu’ils sont, qui ils sont, leur façon d’être aux autres et d’être au monde. Certains font preuve d’une maturité inédite pour leur âge.
Êtes-vous sensible à la dimension sociale de l’Institut Louis Germain ?
Bien sûr, mais ce que je vois avant tout, ce sont des élèves animés par une véritable soif d’apprendre, et c’est sur cette énergie que je veux me concentrer. Je suis consciente que ces élèves doivent parfois surmonter des obstacles liés à leur environnement, comme les responsabilités familiales ou le manque de temps pour se concentrer sur eux-mêmes. Ces difficultés peuvent freiner leur accès à la connaissance. Cela dit, lorsque je suis avec eux, mon objectif est de les encourager à se dépasser sans se focaliser sur ces freins. Je veux les considérer comme n’importe quels élèves prometteurs.
Quelle vision avez-vous du système éducatif français ?
Je suis préoccupée par les disparités qui subsistent entre la capitale et la province. Il existe déjà un fossé entre les opportunités présentes à Paris et celles de sa banlieue, où l’Institut Louis Germain intervient précisément pour combler un besoin criant. Mais à Marseille, la situation est encore plus difficile. Les programmes d’excellence, les partenariats avec de grandes institutions universitaires ou culturelles y sont moins nombreux. Les élèves n’ont pas connaissance des opportunités qui s’offrent loin d’eux, ils sont plus isolés. Cela crée une véritable fracture éducative qui mérite une attention renforcée pour garantir une égalité des chances réelle, quel que soit le lieu de scolarisation.
Selon vous, quels sont les enjeux éducatifs les plus urgents à adresser ?
La connaissance de la langue est un enjeu essentiel. On ne peut pas faire des citoyens libres et heureux s’ils ne maîtrisent pas toutes les subtilités de leur langue.
Certains élèves, même très intelligents ou brillants, ont un niveau de français réellement préoccupant. Un niveau qui n’est pas à la hauteur de leurs ambitions, quel que soit leur futur métier. C’est un enjeu majeur qui à mon sens passe un peu au second plan dans les programmes. Aujourd’hui, au lycée, il n’y a plus de cours de grammaire. Et au collège, on pourrait en faire beaucoup plus.
La littérature peut-elle changer la vie des adolescents ?
Oui, en les inspirant, en les ouvrant à d’autres mondes. Racine écrivait qu’on ne pouvait être inspiré que par ce qui était très éloigné de nous. Et ce qui est le plus éloigné de nous, on le trouve dans les livres. Je ne parle pas forcément de la grande littérature et des grands auteurs. Même la littérature contemporaine peut montrer aux jeunes qu’il existe autre chose que ce qu’ils croient connaître. Ça peut changer une vie.
Y a-t-il un auteur qui ait profondément marqué l’une de vos classes ?
L’année dernière, justement, j’ai travaillé sur Francis Ponge avec une classe de troisième et il y a eu une vraie étincelle.
Pour faire vite, Ponge explique qu’il y a de la poésie partout, et qu’on peut, par conséquent, écrire sur le galet, la crevette, l’éponge. Les élèves ont bien compris son intention. Ils ont vu la poésie autour d’eux, sur les portes, les escaliers, les barrières.
Comment essayez-vous de stimuler leur curiosité pour qu’ils développent leur culture générale ?
Je leur propose souvent des lectures complémentaires. J’essaie aussi de les tenir informés sur la vie culturelle à Marseille, qui est assez riche. À la fin des campus, je leur suggère un petit programme, avec une exposition gratuite ou une conférence à la bibliothèque de l’Alcazar… Ce sont des petites graines qu’on plante chez eux et qui donneront quelque chose plus tard. Et puis, ça leur permet de prolonger les campus.